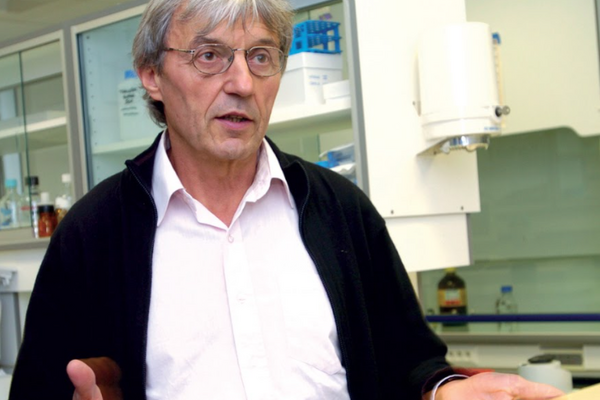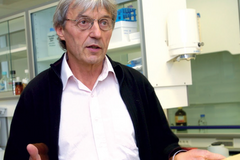Méthodes vidéos
"J’ai Parkinson, mais je ne suis pas parkinsonienne", Claire Garnier
Aujourd’hui âgée de 72 ans, Claire Garnier a appris à l’âge de 55 ans qu’elle était atteinte de la maladie de Parkinson. Révoltée à l’idée de devenir dépendante et de perdre sa précieuse liberté, elle s’est battue pour ne pas laisser la maladie l’entraver. Dans son livre, Sur la route de Parkinson, elle témoigne de ce chemin quasi initiatique.
Jean-Baptiste Talmont
Alternative santé. En tout premier lieu, comment vous portez-vous aujourd’hui ?
Claire Garnier. Je vais très bien. Je me sens très apaisée et très tranquille. En fait, je me sens comme jamais je n’ai été dans ma vie.
Ce livre s’apparente à un véritable chemin, celui d’une femme atteinte par la maladie de Parkinson qui lutte pour que la maladie ne progresse pas…
Je vais aller plus loin. Ce chemin m’a permis de guérir, mais pas seulement de la maladie de Parkinson. Je me suis aperçue en luttant contre la maladie que je vivais à côté de ma vie. Je vivais « par cœur » : je récitais mon rôle de mère, d’épouse, de cadre. Il fallait que je fasse comme.
Vous êtes née et avez grandi en Algérie à une époque de terreur. Votre belle-mère, qui a remplacé votre mère, morte lorsque vous aviez un an, vous a fait également vivre dans un climat terrifiant, en vous maltraitant. Comment déjoue-t-on les impacts de cette peur protéiforme ?
En réalité, à l’époque, je n’avais pas la sensation d’avoir peur. C’est un constat a posteriori. Je n’ai pris conscience de cette trouille terrible qui m’accompagne qu’en faisant une psychothérapie. De même avec les coups donnés par ma belle-mère quand j’étais enfant : je ne les sentais pas sur le moment, mais j’en ai éprouvé les douleurs physiques lors de ma psychothérapie. Avant, je me créais des histoires pour repousser tous ces climats épouvantables.
Ce livre s’intitule Sur la route de Parkinson. Qu’avez-vous trouvé en y cheminant ?
J’ai pris conscience qu’il était essentiel de s’occuper de soi-même avant de s’occuper des autres. J’ai pris conscience qu’« Aime ton prochain comme toi-même » signifiait « Aime-toi d’abord, et tu pourras alors aimer les autres ». Car comment aimer l’autre si on ne sait pas s’aimer ? J’ai enfin découvert, sur cette route, que l’on pouvait réellement pardonner, même si ça scandalisait l’entourage.
On peut dire que ce récit est un témoignage. Mais à qui, et dans quel but ?
Ce récit montre que même face à une adversité terrible, la vie n’est jamais fichue. Par rapport à la maladie, je veux vraiment que les lecteurs sachent que s’ils en ont une, ils ne sont pas la maladie pour autant ! Je me bagarre contre ceux qui m’étiquettent « parkinsonnienne ». Je ne supporte pas ça. Comme si la maladie me déterminait, me définissait, me fixait un statut social, une identité. La première étape pour guérir, c’est de refuser ça, coûte que coûte. Dans les groupes de paroles que j’anime au sein de l’association France Parkinson, je rappelle à tous les patients que s’ils sont malades, ils ne sont pas la maladie. Parce qu’admettre ça, c’est baisser les bras, voire – et je sais que je vais en choquer en le disant – entrer dans une zone de confort. Moi, je veux qu’ils prennent la mesure de la beauté de ce qui n’est pas malade en eux, cette part qui est d’autant plus en vie qu’elle n’est pas atteinte et peut faire des choses. Je me bats pour un changement de regard, pour ne pas être étiquetée.
Votre combat contre la maladie semble avant tout motivé par une révolte contre la dépendance…
C’est vrai. Parce qu’être dépendant, c’est être privé de liberté. J’ai été une enfant enfermée dans une chambre et privée des possibilités de faire ce qu’elle voulait. J’ai dû arracher ma liberté de mouvements et d’action à ma belle-mère. Il m’était inconcevable, à 55 ans, de reperdre cette si précieuse liberté. J’ai refusé que mon propre corps m’interdise d’en profiter.
Si vous aviez la possibilité de corriger le scénario de votre vie, que changeriez-vous ?
Je crois que la maladie de Parkinson est apparue dans un but : réparer mon existence ; m’apprendre ce que c’est que vivre. Parce qu’une fois encore, avant, je ne vivais pas. Je ne regrette rien. J’ai 72 ans et je porte un regard profondément bienveillant sur ma vie.
Quels jalons poseriez-vous sur votre route de Parkinson ?
J’ai connu deux grands déclics durant mon parcours. Le premier, c’est avec le décodage biologique. Lors de mon premier stage, pendant une sieste, j’ai entendu des voix d’enfants. Je me suis levée d’un bond. J’ai fui en courant. Sur le moment, je ne comprenais pas ce qui m’arrivait ; maintenant, je sais que j’étais redevenue l’enfant que j’ai été, enfermée dans sa chambre quand ses petites sœurs étaient en train de jouer dans le jardin. Je n’avais pas le droit de les rejoindre. Je n’avais même pas le droit d’ouvrir ma fenêtre quand elles jouaient. J’ai compris l’impact de mon enfance dans ma vie au présent, voire dans ma maladie de Parkinson. Une fois que cette prise de conscience faite, le lendemain, j’ai pu danser ! Le deuxième déclic a eu lieu avec la méthode de libération des cuirasses (MLC). J’ai eu une grande émotion à un moment : je « retrouvais » ma mère et je l’implorais de ne pas partir. Quand l’animatrice m’a rejointe, je lui ai sorti : « Tu ne partiras que quand je te le dirai. ». Bien sûr, je m’adressais là à ma mère.
Comme on l’entend, vous avez mené votre combat avec l’appui des médecines alternatives. Quelles sont celles que vous utilisez en ce moment ?
Je suis toujours avec attention la régénération somatopsychique. Il s’agit d’un nettoyage des cellules. C’est un protocole de soins en huit séances très intéressant. Mais attention, je n’ai jamais cessé les protocoles allopathiques de fond. J’ai toujours pris les soins alternatifs en complément.
Dans votre livre, vous assimilez le décodage biologique à une enquête sur la maladie, sur son sens. En l’occurrence, vous découvrez que pour vous, « bouger est un danger ». Une fois que l’on sait ça, qu’en fait-on ?
Oui, c’est vrai que le décodage biologique, c’est avant tout enquêter sur soi. C’est changer de regard sur une maladie, accepter qu’elle soit une conséquence de traumatismes de son existence encore à résoudre. Ma belle-mère me séquestrait, m’humiliait, me frappait. Si je bougeais – même un tout petit mouvement – quand elle me l’interdisait, cela pouvait justifier des coups. Il est aussi vrai que dans l’Algérie en guerre, avec des bombes au quotidien et des cadavres dans les rues, bouger pouvait signifier risquer sa vie… Avec le décodage, j’ai réalisé que chez moi, bouger était égale à insécurité et danger. Et là, on est vraiment au cœur même de la maladie de Parkinson, qui entrave le mouvement. Qu’est-ce qu’on fait de ça, demandez-vous ? D’abord, j’ai continué à travailler pour apaiser cette peur. Je parle de thérapies par la parole et analytiques, de la PNL ou de thérapies par les mouvements, comme le Biodanza.
Qu’est-ce qui vous a semblé le plus efficace – et le moins – parmi la large palette de pratiques que vous avez essayées ?
Ce qui m’a apporté le plus de bonheur, je dirais que c’était la méthode de libération des cuirasses (MLC), le décodage biologique. Et le moins, c’est d’avoir croisé des thérapeutes qui pensaient à ma place ou prétendaient que leur méthode était la meilleure. Ce n’est pas le thérapeute qui a la solution. C’est le patient.
On se rend bien compte, avec votre parcours, que la guérison c’est un combat individuel. Vous ne vous êtes pas abandonnée aux mains de la médecine, vous vous êtes bagarrée avec l’aide des médecins et des thérapeutes.
C’est le problème. Les gens se laissent aller, ils pensent que la médecine fait tout le travail. J’échange beaucoup avec des malades. Certains ont le réflexe de me demander ce que je prends quand je tremble. Cette façon de toujours vouloir faire taire le symptôme, de médicaliser pour ne pas ressentir, c’est terrible ! Je ne prends rien en cas de crise pour ma part. Je laisse faire.
Quelles activités menez-vous en ce moment ?
J’anime un groupe de paroles avec l’association France Parkinson depuis cinq ans. Souvent, je tente de déjouer des certitudes. Je me bats contre ceux qui sont certains que depuis qu’ils ont la maladie, ils ne peuvent plus rien faire. Je leur demande ce qu’ils font depuis qu’ils ont la maladie, et qu’ils ne faisaient pas avant. Et tous trouvent quelque chose… Dans ce groupe, j’ai envie que chacun découvre le potentiel qui est en lui pour faire régresser les symptômes. Je dis toujours aux personnes atteintes de Parkinson qu’elles sont plus grandes et plus fortes que leur maladie.
En savoir plus :
- Sur la route de Parkinson, éd. Albin Michel, 272 p., 19 €.
- Le site de Claire Garnier, www.surlaroutedeparkinson.fr
- L'association France Parkinson, www.franceparkinson.fr

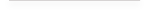 Découvrir le numéro
Découvrir le numéro