
Méthodes vidéos
"Soigner avec les plantes, c’est aussi s’interroger sur leur mode de production"" Interview d'Aline Mercan
Dans son dernier livre*, Aline Mercan, médecin, phytothérapeute et ethnobotaniste montre comment le business de la phytothérapie met en danger les espèces végétales à travers le monde. Elle rappelle qu’il existe des alternatives locales pour soulager de nombreux maux et se soigner sans piller la planète.
Lucile de la Reberdiere
Se soigner avec les plantes peut nuire à la planète et à sa propre santé. C’est difficile à admettre lorsqu’on a le sentiment de bien faire en choisissant des solutions naturelles. Comment accepter cette idée ?
En ne voyant pas cela comme une nouvelle contrainte, en s’y prenant autrement. Il y a toute une pharmacopée disponible dans le respect de la nature. Pas besoin de s’angoisser, il existe des alternatives. On peut difficilement prendre conscience que l’on est en train de tout piller, et penser au contraire que ça ne concerne pas les plantes puisque mes intentions sont bonnes. Je ne remets pas du tout en cause les intentions de celui qui utilise les plantes dans un désir de se rapprocher de la nature, mais il fait confiance à un système de production qui, lui, n’est pas respectueux. C’est surtout aux thérapeutes que je m’adresse. Le patient ne peut pas être spécialiste de tout, la phytothérapie, c’est un monde complexe. Mais le thérapeute qui se passionne pour les vertus des plantes sans se demander comment est produit ce qu’il conseille, c’est embêtant
Cela reste un propos rare. Vous êtes la seule à lancer ces messages d’alerte ?
Chez les thérapeutes, c’est peut-être encore un peu rare. En revanche, vous avez des ethno-écologues qui travaillent sur la question des cueillettes depuis des années mais on ne les entend pas en dehors de leur réseau. L’ONG Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) se positionne très fortement sur les plantes menacées, et il y a des labels qui plaident pour de bonnes pratiques de cueillette et de gestion de la ressource sauvage. Je ne suis pas une lanceuse d’alerte, mais il s’agit très souvent de savoirs spécialisés qui peinent à arriver jusqu’au grand public. Mon rôle en tant que thérapeute était d’en parler.
La phytothérapie obéit à un marché mondial qui modifie les traditions de cueillette. On cueille plus, plus loin, plus longtemps… au point de se retrouver avec des plantes sans principes actifs car cueillies trop tôt ?
Oui, et c’est très bien décrit pour les racines de rhodiole qui, normalement, se ramassent après floraison, pas avant, pour les saussures laineuses qui sont ramassées à tous les stades ou le cordyceps que l’on ramasse tard, quand il est en train de sporer. Évidemment, ça n’aura pas du tout la même activité pharmacologique. Le consommateur sur Internet ne sait pas toujours ce qu’il achète. Parfois, un grossiste a acheté la plante à un autre grossiste, donc savoir comment la plante a été ramassée au départ, c’est mission impossible.
[lireaussi:7966]
La mise en culture est le seul gage de sécurité ?
Sauf que c’est impossible pour certaines plantes. Si vous changez la plante de biotope, elle ne fabrique plus la même chose. Prenez la sarriette : si vous la plantez au sud de Valence, elle va produire ses fameux phénols, qui pour nous sont des principes anti-infectieux mais pour elle sont des moyens de défense. Si vous la montez plus au nord et qu’elle n’a plus le stress environnemental d’un terrain sec et très ensoleillé, elle va fabriquer beaucoup moins de ces principes actifs. Bien sûr, ça ira pour la cuisine mais ce sera moins bien pour se soigner. Vous avez la même chose avec la rhodiole ou l’edelweiss. Ce dernier se cultive très bien mais il fabrique des antioxydants en altitude qu’il ne fabriquera plus si on le descend. Il faut toujours faire en sorte qu’une plante soit cultivée au plus près de son biotope naturel.
Selon vous, l’aromathérapie donne des dérives pires. Expliquez-nous…
On n’a jamais utilisé des végétaux de manière aussi concentrée dans toute l’histoire. On entend souvent parler des Égyptiens, de l’Antiquité, mais c’est faux. La distillation n’existait pas. Vous n’avez pas de traces d’huiles essentielles à effet thérapeutique avant le XXe siècle. Ce n’est pas un hasard si l’on fait ça maintenant, dans une société de l’hypertrophie. On surconcentre les principes actifs des plantes, mais ce n’est pas parce que c’est plus fort que c’est plus efficace. Ça, c’est un biais cognitif vieux comme le monde. Et l’aromathérapie, ça demande des quantités de végétaux phénoménales. Consommer une goutte d’huile essentielle d’origan revient à avaler un pied entier. Il faut 4 tonnes de pétales de roses de Damas pour faire un kilo d’huile essentielle. L’exemple du romarin est particulièrement aberrant. On en distille alors qu’on sait que ses principes actifs sont solubles dans l’eau, c’est-à-dire en tisane. Parler de l’action hépatoprotectrice de l’huile essentielle de romarin est donc pharmacologiquement faux.
Est-ce que tout ne part pas d’une fascination pour le remède, surtout quand celui-ci vient de loin ?
Tout à fait. Dans mon livre, je cite William Osler (considéré comme le père de la médecine moderne, NDLR), qui dit que ce qui distingue l’homme de l’animal, c’est sa volonté d’avaler des médicaments. On vit à une époque où le soin consiste à avaler quelque chose. Or, dans beaucoup de médecines traditionnelles, on commence par des conseils de comportement, on s’intéresse à l’alimentation, à la manière dont les gens vivent, à leurs poisons mentaux. On va d’abord corriger tout ça. J’ai un ami médecin tibétain qui a refusé de soigner une personne de ma famille parce qu’elle n’était pas prête à changer quoi que ce soit dans sa vie. Elle voulait qu’on lui donne quelque chose. Il y a cent ans, vous aviez les plantes autour de chez vous et peut-être un peu d’aspirine pour vous soigner. Aujourd’hui, vous pouvez commander la pharmacopée du monde entier en un clic, alors c’est facile.
Parmi les plantes à abandonner, vous citez l’harpagophytum. Pourquoi ?
Il y a une pression terrible sur l’harpagophytum parce qu’il y a un marché mondial. Du coup, on n’est jamais vraiment sûr de sa qualité. Quand on met de la poudre dans des gélules, comment savoir ce qu’elles contiennent ? Une étude américaine a révélé que, la plupart du temps, il ne s’agit pas d’Harpagophytum procumbens mais d’Harpagophytum zeyheri dont une polémique discute son efficacité par rapport au premier. Souvent, on trouve aussi d’autres plantes. L’harpagophytum, c’est un énorme marché qui est parti en vrille. Il y a eu une grosse tentative pour structurer la culture, mais la pression mondiale pousse toujours les gens à aller le ramasser en sauvage. Alors qu’il y a des alternatives. On conseille la scrofulaire noueuse, qui contient des harpagosides et qui est très facile à cultiver sous nos latitudes, c’est même envahissant, j’en ai plein mon jardin. Son profil chimique est proche, c’est une plante anti-inflammatoire bien documentée. Cela dit, imaginons que la pression redescende grâce aux alternatives, rien ne dit qu’on ne pourra pas consommer de l’harpagophytum en toute confiance un jour. Il faudrait moins de pression sur la ressource et une labélisation fiable sur du cultivé.
Vous invitez aussi à limiter la réglisse. Vous parlez bien de la variété asiatique, pas de la réglisse française que l’on trouve en magasins bio ?
Pas seulement. Vous trouvez deux espèces de réglisse : la Glycyrrhiza uralensis qui est effectivement d’origine asiatique et qui a été complètement démolie depuis un moment ; on ne la rencontre quasiment plus en sauvage. Mais la Médecine traditionnelle chinoise commence aussi à acheter la Glycyrrhiza glabra, d’origine méditerranéenne. Sauf que le marché n’est pas encore assez structuré pour répondre à une telle demande. Bien sûr, on peut quand même consommer de la réglisse, mais je pense qu’il faut demander aux personnes qui en vendent et aux producteurs si elle est cultivée en France et, s’ils ne savent pas répondre, il faut mettre un peu de pression pour que la filière française se structure.
La pandémie a-t-elle aggravé la pression sur la demande de plantes ?
Sur les plantes et sur les cueilleurs, qui sont généralement des populations pauvres, défavorisées, des minorités ethniques… Le rapport de l’organisation Traffic1 que je cite également inquiète parce que le Covid entraîne de plus en plus de cueillettes. Le cueilleur fait ce qu’il peut pour gagner sa vie. Il n’a pas les moyens de faire de la qualité ni de respecter des normes qu’il ne connaît pas. Il ramasse tout ce qu’il peut, sinon c’est un autre qui ramassera. C’est produit dans des pays pauvres, mais ça acquiert de la valeur ici, donc on prend des ressources à des gens pauvres qu’on paye mal pour faire de la plus-value chez nous. Ce n’est pas très éthique.
[lireaussi:6678]
Peut-on imaginer un commerce équitable de la phytothérapie comme avec l’alimentation ?
Oui, je cite le guarana pour lequel il y a eu un énorme travail. Tout un consortium s’est créé autour de cette plante avec des tribus locales qui se sont organisées pour le produire de manière respectueuse de l’environnement, le transformer et le mettre en vente directe de telle sorte qu’elles soient payées très correctement. Quitte à aller chercher une plante exotique, autant le faire avec des communautés.
Quels sont vos conseils pour consommer la phytothérapie de manière responsable ici ?
Avant d’avaler quoi que ce soit, on peut se demander si on a fait le tour de ce qui ne va pas très bien dans notre vie. Après, regarder ce que l’on a déjà dans sa pharmacopée pour éviter d’acheter un énième produit. J’ai plein de patients qui ont des flacons d’huiles essentielles en double, en triple… Ensuite, privilégier la phytothérapie avant l’aromathérapie. Si je veux protéger mon foie, je vais prendre de la tisane de romarin, si j’ai un rhume, de la tisane d’origan. Il y a un tas d’indications pour lesquelles la phyto fait merveille. On a des millénaires de recul et une grande sécurité. Si l’on veut utiliser des huiles essentielles, pourquoi ne pas privilégier les formes déconditionnées et faire faire la préparation en herboristerie ou en pharmacie plutôt que d’acheter un flacon entier dont une partie risque de se périmer. Enfin, dans notre culture, tout le monde donne des conseils à tout le monde. Mieux vaut trouver un thérapeute en qui l’on a confiance et ne pas multiplier les compléments alimentaires. J’accompagne des groupes de femmes touchées par un cancer du sein qui dépensent parfois des centaines d’euros par mois et finissent par ne plus partir en vacances parce qu’elles prennent tout ce qu’on leur recommande. Il y a une femme avec un cancer hormonodépendant qui a pris beaucoup d’huile essentielle de lavande alors que celle-ci est suspectée d’avoir des effets phyto-œstrogéniques. Il y a tellement de plantes qui ont fait leurs preuves, comme la valériane, l’aubépine, la passiflore, l’agripaume, qu’on a du mal à comprendre pourquoi le thérapeute est allé chercher une huile essentielle sur laquelle on a un doute. C’est pareil avec le curcuma, qui possède des interactions avec le tamoxifène (médicament ayant une action principalement antiœstrogène, NDLR). Ces risques ne sont souvent pas connus des thérapeutes eux-mêmes.
Tout ceci plaide en faveur de la réhabilitation du métier d’herboriste, c’est lui, le meilleur garant ?
Normalement, un pharmacien bien formé en phytothérapie devrait être la bonne personne, notamment pour les interactions plantes-médicaments qu’il connaît parfois mieux que le médecin. L’herboriste, ça pourrait aussi être son travail, mais il faudrait monter le niveau des formations. Aujourd’hui, celles-ci attirent des gens de tous horizons qui se forment les week-ends. S’ils doivent se retrouver à un comptoir en face de quelqu’un qui fait de l’immunothérapie ou de la chimio… il faudrait que ça devienne un vrai métier avec une formation à temps plein. Joël Labbé, qui a préfacé mon livre, travaille depuis trois ans sur un projet de loi pour rétablir le diplôme d’herboriste. Je fais d’ailleurs partie de la commission. Pierre Champy2 a créé une licence pro d’herboristerie avec l’université Paris V. Je suis hypersollicitée pour faire un cours sur le contenu de mon livre au sein du DU de Grenoble ainsi qu’à Bruxelles et à Rennes. Tout cet univers est en train de bouger.
Références :
- www.traffic.org
- Docteur en pharmacie et docteur en chimie des substances naturelles de l’université Paris-Sud.

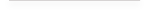 Découvrir le numéro
Découvrir le numéro 















































































