Accueil Dossiers Le burn-out, qu'est-ce que c'est ?
Le burn-out, qu'est-ce que c'est ?
« Docteur, je me sens fatigué, je fais un burn-out, je dois souffler ». Combien de fois un médecin entend-il cet autodiagnostic ? Trop souvent, pour être honnête, d’autant que ce terme est galvaudé par une grande presse qui ne saisit pas toujours la gravité du sujet. Non, il ne faut pas trois semaines pour en sortir… quand on en sort.
Il faudrait être Hibernatus pour ne pas avoir entendu parler du burn-out. Ces dernières années, ce « syndrome d’épuisement professionnel » (SEP) assure de bonnes audiences pour les médias, qui du coup se passionnent pour lui… tardivement, certes. Plus précisément, depuis que le burn-out a apposé sa signature sur les dépouilles des salariés qui se sont donné la mort sur leur lieu de travail, chez Renault, La Poste ou France -Telecom. C’était dans les années 2000. Avant, on n’en parlait peu ou mal. Et pour cause, difficile de traiter d’une maladie qui n’en est pas une, qu’on aborde à tout bout de champ, alors même que la communauté scientifique ne sait pas quoi en faire.
Car si le concept est apparu dans les années 1970 quand sont apparus les cas de karoshi, des salariés japonais morts suite à une surcharge de travail, il n’est classé nulle part comme maladie. Même le DSM-IV, la bible des psys, celle qui est capable de décréter que la timidité est une maladie mentale, n’en cite pas une seule ligne. Étonnant non ? Quoique… Peut-être que la ligne éditoriale de cette « bible » s’interdit de froisser les gros labos. Car le burn-out incrimine directement l’entreprise, le travail, son cadre, son management, son organisation.
Mal universel
Il est le miroir reflétant la déshumanisation brutale des rapports sociaux et professionnels qu’exige et impose notre modèle économique. Le burn-out est à l’humanité que nous portons en nous ce que la cirrhose est au foie. Le syndrome d’épuisement par le travail est la maladie de notre humanité, nécrosée par la déshumanisation de nos rapports, des modes de management en entreprise, d’un système économique aux répercussions multiples. Cette déshumanisation a ses règles, sa méthodologie, ses concepts, ses principes, certains élaborés par des psychiatres, des psychologues, transmis à de jeunes étudiants par les grandes écoles de commerce et de management.
Nulle structure n’offre d’herbe plus verte que l’autre, pas plus les multinationales que les associations, les hôpitaux que les groupes de presse, les cabinets d’architecte ou d’avocats que la fonction publique. Et personne n’est à l’abri. Car des agriculteurs aux médecins, des cordonniers aux banquiers, des mères ou pères au foyer aux ouvriers, le syndrome d’épuisement par le travail peut embraser n’importe lequel d’entre nous. Même les patrons, même les DRH. Ils peuvent se réveiller un matin, à bout, envahi de ce vide indéfini qui succède au brasier. Un brasier que ce vide singulier finit d’éteindre aussi brutalement qu’était engloutie l’image quand on éteignait les vieux téléviseurs à tube cathodique. Je me -rappelle qu’il restait durant quelques secondes un point blanc, au milieu de l’écran noir. Un burn-out, c’est un peu ça aussi : engloutir un individu et le réduire à ce petit point blanc au centre d’un écran devenu noir. Juste avant, il projetait encore le film de la vie que chaque victime réalisait avec soin, séquence après séquence. Jusqu’à ce que ...
Cet article est réservé à nos abonnés. Vous êtes abonnés ? Connectez-vous
Pourquoi cet article est réservé aux abonnés ?
Depuis maintenant près de 30 ans, Alternative Santé promeut les bienfaits des médecines douces ou des approches complémentaires.
Alors qu'elle sont attaquées de toute part avec la plus grande virulence, notre missions est plus que jamais essentielle pour défendre une autre vision de la santé.
C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour nous soutenir dans nos actions d'information. En effet, si nous souhaitons garder notre indépendance éditoriale, seul votre soutien financier peut nous permettre de continuer notre mission :
- celle de dénoncer les scandales et dérives inquiétantes dans le monde de la santé, de mettre en lumière les effets indésirables
- celle de faire connaitre les solutions préventives et les remèdes naturels efficaces au plus grand nombre
- celle de défendre le droit des malades, des usagers de santé et des médecins à choisir librement les meilleurs remèdes.
Comme vous le savez certainement, nous ne mettons aucune publicité dans notre journal et restons libres de toute pression. Nous souhaitons garder toute notre indépendance, mais cette liberté a un coût.
La meilleure façon de nous aider et de soutenir une presse indépendante est donc de vous abonner à notre journal !
Je m'abonne
En aucun cas les informations et conseils proposés sur le site Alternative Santé ne sont susceptibles de se substituer à une consultation ou un diagnostic formulé par un médecin ou un professionnel de santé, seuls en mesure d’évaluer adéquatement votre état de santé
Sociologie du burn-out : ce qu'il faut savoir pour ne pas sombrer
Sortir de l’emprise du burn-out
Quatre exercices pour vaincre le burn-out
Les médecins malades de la médecine
La méditation anti burn-out, de Dr Marine Colombel (éd. Marabout)
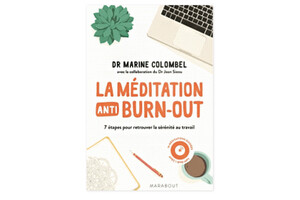


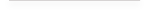 Découvrir le numéro
Découvrir le numéro
Sociologie du burn-out : ce qu'il faut savoir pour ne pas sombrer
Sortir de l’emprise du burn-out
Quatre exercices pour vaincre le burn-out
Les médecins malades de la médecine
La méditation anti burn-out, de Dr Marine Colombel (éd. Marabout)
Quand le stress devient insupportable : les quatre étapes qui mènent au burn-out