Accueil Dossiers Quand le coeur s'emballe
Quand le coeur s'emballe
Initialement appelée fibrillation auriculaire, la fibrillation atriale connue depuis le début du 20ème siècle se caractérise par une accélération et une altération du rythme cardiaque (tachyarythmie).
Son incidence (nombre de nouveaux cas enregistrés chaque année au sein d'une population donnée) et sa prévalence (nombre total de cas enregistrés au sein d'une population donnée) - les plus élevées de tous les troubles du rythme cardiaque - augmentent rapidement avec l'âge à partir de 50 ans.
Aujourd'hui, la FA (acronyme par laquelle la fibrillation atriale est couramment dénommée) touche particulièrement l'Amérique du Nord, mais quel que soit le continent considéré, elle ne cesse de "gagner" du terrain partout où le progrès technologique s’installe[1].
La FA revêt plusieurs formes selon la durée de ses épisodes. Elle est qualifiée de[2] :
- Paroxystique lorsque les crises n'excèdent pas une semaine et se résolvent sans aucune intervention thérapeutique.
- Persistante lorsque la durée des crises est comprise entre 1 et 4 semaines, quelle que soit la façon dont la résolution est obtenue, spontanément ou sous l'effet d'un traitement.
- Permanente lorsque l'arythmie persiste quoi qu'on ait entrepris.
Mais, quelque visage qu’elle emprunte, la FA expose à des complications sérieuses dont l’évolution peut être fatale. Notion nouvelle, car jusqu’à il y a quelques années, la forme paroxystique était considérée comme bénigne.
Comme pour toute pathologie sur laquelle l’attention est subitement portée, les connaissances à propos de la FA ont rapidement évolué au cours de la dernière décennie, sa dangerosité a été mieux cernée, la liste des facteurs de risque s’est considérablement allongée et de nouvelles stratégies thérapeutiques ne cessent d’apparaître. Toutefois, certaines inconnues demeurent, notamment quant aux causes de certaines FA survenant sur un terrain apparemment non propice. Certes, le voile se lève peu à peu avec l’intérêt porté depuis quelques années par la médecine officielle aux implications du mode de vie dans la genèse de ...
Cet article est réservé à nos abonnés. Vous êtes abonnés ? Connectez-vous
Pourquoi cet article est réservé aux abonnés ?
Depuis maintenant près de 30 ans, Alternative Santé promeut les bienfaits des médecines douces ou des approches complémentaires.
Alors qu'elle sont attaquées de toute part avec la plus grande virulence, notre missions est plus que jamais essentielle pour défendre une autre vision de la santé.
C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour nous soutenir dans nos actions d'information. En effet, si nous souhaitons garder notre indépendance éditoriale, seul votre soutien financier peut nous permettre de continuer notre mission :
- celle de dénoncer les scandales et dérives inquiétantes dans le monde de la santé, de mettre en lumière les effets indésirables
- celle de faire connaitre les solutions préventives et les remèdes naturels efficaces au plus grand nombre
- celle de défendre le droit des malades, des usagers de santé et des médecins à choisir librement les meilleurs remèdes.
Comme vous le savez certainement, nous ne mettons aucune publicité dans notre journal et restons libres de toute pression. Nous souhaitons garder toute notre indépendance, mais cette liberté a un coût.
La meilleure façon de nous aider et de soutenir une presse indépendante est donc de vous abonner à notre journal !
Je m'abonne
En aucun cas les informations et conseils proposés sur le site Alternative Santé ne sont susceptibles de se substituer à une consultation ou un diagnostic formulé par un médecin ou un professionnel de santé, seuls en mesure d’évaluer adéquatement votre état de santé


 Découvrir le numéro
Découvrir le numéro 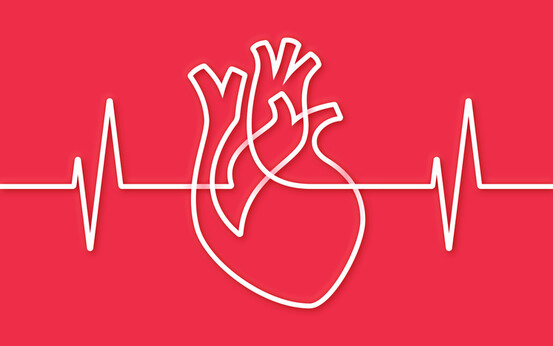
Troubles du rythme : les médecines alternatives entrent en jeu
Êtes-vous une personne à risques cardiaque ?
Traitements cardiaques : les plus et les moins de l'allopathie
Angine de poitrine : la nattokinase en soutien ?
Comment prévenir
les troubles du rythme cardiaque ?
Les multiples bienfaits de la coenzyme Q10 (CoQ10) pour la santé