Accueil Dossiers Physiologie et physiopathologie du jeûne
Physiologie et physiopathologie du jeûne
Il n’est quasiment plus un thérapeute qui ne conseille aujourd’hui le jeûne comme outil thérapeutique. Il n’est qu’à voir les religions qui ont toutes inclus le jeûne comme pratique obligatoire. C’est qu’elles ont bien compris l’intérêt sanitaire du jeûne. De tout temps, il a accompagné l’humanité et semble, à juste titre, retrouver enfin ses lettres de noblesse.
- Partie 4
Un ensemble de réactions biochimiques est nécessaire pour que les différents systèmes indispensables à la pérennisation du processus vital fonctionnent de façon optimale, quelles que soient les stimulations environnementales.
Au repos, seules les fonctions essentielles continuent d’œuvrer. Les dépenses énergétiques qu’elles causent, représentent environ 70 % du métabolisme total, en contexte ordinaire. Elles sont regroupées sous les vocables de dépense énergétique de repos (DER) ou de métabolisme de base (MdB).
Du fait que les apports alimentaires sont périodiques voire irréguliers, l’organisme stocke les substrats énergétiques (glucides, lipides, protéines) ingérés en excès au moment des repas, puis puise dans ces mêmes réserves tout au long de la journée et de la nuit, en fonction des besoins de l’instant.
En cas de disette ou de restriction calorique volontaire, la seconde phase de cette programmation est amenée à durer plus longtemps avec, pour conséquences, des effets sur l’organisme très spécifiques.
Trois définitions importantes
Glycogénolyse : production de glucose à partir du glycogène qui est la forme de stockage du glucose dans le foie.
Néoglucogenèse : production de glucose à partir de substance non glucidique comme le pyruvate, le lactate, le glycérol et la majorité des acides aminés.
Lipolyse : décomposition des graisses en acides gras et en glycérol.
Modifications biochimiques induites par le jeûne
Physiologiquement, pendant la nuit, les besoins énergétiques de repos sont satisfaits grâce à l’oxydation des glucides pour environ 40 à 50 %, des lipides pour 30 à 40 % et des acides aminés pour seulement 15 à 20 %.
Dès que le jeûne dépasse la demi-journée, la DER diminue et plus le jeûne dure, plus la DER continue de diminuer jusqu’à se stabiliser aux alentours des 60 % de sa valeur de départ.
La production de glucose qui est assurée par le foie provient d’abord, à peu près à parts égales, de la glycogénolyse et de la néoglucogenèse, puis après épuisement des réserves en glycogène (c’est-à-dire au bout de 24 à 36 heures), de plus en plus de la néoglucogenèse. Rapidement, la production de glucose baisse ainsi que son utilisation. Ainsi, la consommation de glucose au niveau cérébral diminue des deux tiers en 8 jours et est divisée par six au bout de 40 jours.
L’insuline est moins sécrétée, ce qui stimule la lipolyse. Les acides gras ainsi libérés sont transformés en corps cétoniques par le foie et les muscles afin de produire l’énergie nécessaire à tout l’organisme et notamment au cerveau. Dans le même temps, la sécrétion de glucagon augmente, ce qui incite le foie à la glycogénolyse, à la néoglucogenèse et à la cétogenèse.
La thyroxine (T4) est inactivée sous forme de 3,3’,5’-triiodothyronine (T3 inverse), ce qui réduit le métabolisme de base.
Le foie et les corps cétoniques
Au nombre de trois, ...
Cet article est réservé à nos abonnés. Vous êtes abonnés ? Connectez-vous
Pourquoi cet article est réservé aux abonnés ?
Depuis maintenant près de 30 ans, Alternative Santé promeut les bienfaits des médecines douces ou des approches complémentaires.
Alors qu'elle sont attaquées de toute part avec la plus grande virulence, notre missions est plus que jamais essentielle pour défendre une autre vision de la santé.
C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour nous soutenir dans nos actions d'information. En effet, si nous souhaitons garder notre indépendance éditoriale, seul votre soutien financier peut nous permettre de continuer notre mission :
- celle de dénoncer les scandales et dérives inquiétantes dans le monde de la santé, de mettre en lumière les effets indésirables
- celle de faire connaitre les solutions préventives et les remèdes naturels efficaces au plus grand nombre
- celle de défendre le droit des malades, des usagers de santé et des médecins à choisir librement les meilleurs remèdes.
Comme vous le savez certainement, nous ne mettons aucune publicité dans notre journal et restons libres de toute pression. Nous souhaitons garder toute notre indépendance, mais cette liberté a un coût.
La meilleure façon de nous aider et de soutenir une presse indépendante est donc de vous abonner à notre journal !
Je m'abonne
En aucun cas les informations et conseils proposés sur le site Alternative Santé ne sont susceptibles de se substituer à une consultation ou un diagnostic formulé par un médecin ou un professionnel de santé, seuls en mesure d’évaluer adéquatement votre état de santé


 Découvrir le numéro
Découvrir le numéro  Au terme d'un jeûne de 7 jours, les sujets sans surpoids notent une amélioration de la qualité de leur sommeil.
Au terme d'un jeûne de 7 jours, les sujets sans surpoids notent une amélioration de la qualité de leur sommeil.



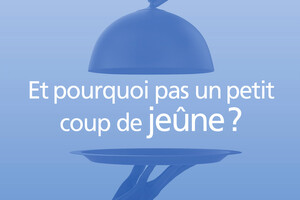

Les multiples dimensions du jeûne
Le jeûne en pratique
Jeûne et données scientifiques disponibles
Que diriez-vous d’un petit coup de jeûne ?
Le jeûne intermittent pourrait-il révolutionner la vie des patients atteints de lésions nerveuses ?