Accueil Dossiers Virus courants : un boulevard pour de nouvelles maladies ?
Virus courants : un boulevard pour de nouvelles maladies ?
Une grande partie de la population héberge, sans le savoir généralement, de nombreux virus à l’état latent. Or ceux-ci peuvent un jour devenir actifs – selon différents facteurs, liés à l'environnement, à la vaccination, à la constitution génétique de leurs porteurs… On les soupçonne à présent d’être liés à nombre de maladies chroniques invalidantes.
Une infection froide, dite aussi « à bas bruit », commence souvent par un incident anodin à première vue. Une petite poussée de fièvre, une fatigue persistante, une douleur articulaire ou musculaire récurrente, une paupière qui sautille toute seule, des arythmies, des vertiges, des rougeurs cutanées, etc. On pourrait rallonger la liste presque à l’infini tant les manifestations peuvent varier d’un individu à l’autre. Mais, avec le temps, « ça » va s’installer et s’aggraver, quelques fois très rapidement, d’autres fois plus lentement, tantôt avec un symptôme unique, tantôt avec plusieurs.
Derrière les maladies « classiques », aux premiers rangs des causes de mortalité (cancers, cardiopathies et maladies dégénératives), pointent désormais des maladies chroniques, aux contours beaucoup plus flous, complexes à identifier et plus encore à traiter. Elles ont pour noms syndrome de fatigue chronique, maladie auto-immune, hypersensibilité chimique multiple, hypersensibilité électromagnétique, maladie de Crohn… mais aussi troubles du comportement, schizophrénie ou encore maladie de Parkinson.
Une capacité d’adaptation lente
Ces dernières années, la médicamentation forcenée, les vaccinations à l’aveugle, sans compter le développement de nombreux facteurs environnementaux délétères (pollution chimique et électromagnétique…) ont été propices à l’affaiblissement des organismes, tandis que, de leur côté, les ...
Cet article est réservé à nos abonnés. Vous êtes abonnés ? Connectez-vous
Pourquoi cet article est réservé aux abonnés ?
Depuis maintenant près de 30 ans, Alternative Santé promeut les bienfaits des médecines douces ou des approches complémentaires.
Alors qu'elle sont attaquées de toute part avec la plus grande virulence, notre missions est plus que jamais essentielle pour défendre une autre vision de la santé.
C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour nous soutenir dans nos actions d'information. En effet, si nous souhaitons garder notre indépendance éditoriale, seul votre soutien financier peut nous permettre de continuer notre mission :
- celle de dénoncer les scandales et dérives inquiétantes dans le monde de la santé, de mettre en lumière les effets indésirables
- celle de faire connaitre les solutions préventives et les remèdes naturels efficaces au plus grand nombre
- celle de défendre le droit des malades, des usagers de santé et des médecins à choisir librement les meilleurs remèdes.
Comme vous le savez certainement, nous ne mettons aucune publicité dans notre journal et restons libres de toute pression. Nous souhaitons garder toute notre indépendance, mais cette liberté a un coût.
La meilleure façon de nous aider et de soutenir une presse indépendante est donc de vous abonner à notre journal !
Je m'abonne
En aucun cas les informations et conseils proposés sur le site Alternative Santé ne sont susceptibles de se substituer à une consultation ou un diagnostic formulé par un médecin ou un professionnel de santé, seuls en mesure d’évaluer adéquatement votre état de santé


 Découvrir le numéro
Découvrir le numéro  L'urbanisation en zone tropicale, une source potentielle de pandémies.
L'urbanisation en zone tropicale, une source potentielle de pandémies.

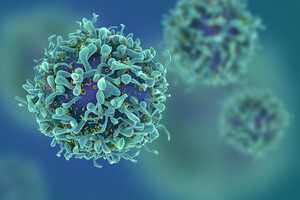


Virus courants : un boulevard pour de nouvelles maladies ?
Virus courants : errance médicale et limite de l’allopathie
Virus courants : des bombes à retardement
Virus courants : les pathologies associées
Virus dormant : les réponses naturelles