Accueil Dossiers Stratagème placebo : une efficacité déstabilisante
Stratagème placebo :
une efficacité déstabilisante
Le placebo et son effet associé, utilisé dès l’Antiquité, a depuis été maintes fois éprouvé par l’analyse scientifique moderne. Les chercheurs, qui ont identifié ses ressorts psychologiques et les conditions de son efficacité, ont également cerné ses risques et ses effets secondaires.
Administré à des patients, un placebo peut diminuer sensiblement la douleur aiguë ou chronique, l’intensité de la migraine, la dépression, le rejet social. Il est aussi capable de ralentir la fréquence cardiaque et les chiffres tensionnels quand ceux-ci sont élevés, de régulariser les constantes biologiques et parfois même d’améliorer les affections dites incurables. Toutefois, son effet n’est pas prévisible comme l’est l’effet pharmacologique, et son action dans le temps est plus courte.
Les ressorts psychologiques qu’il active sont plus que mystérieux : si l’effet placebo est nettement plus puissant lorsque le patient ne sait pas qu’il est manipulé par son soignant, il reste loin d’être insignifiant quand la personne est avertie que ce qu’on lui administre est ou n’est qu’un placebo… Mieux encore : lorsqu’il est donné à des volontaires sains, le placebo induit des manifestations chez 15 à 30 % d’entre eux !
Ces exemples issus des innombrables études dédiées au phénomène placebo ont conclu à son indéniable efficacité chez les sujets répondeurs. Une efficacité telle que certaines firmes pharmaceutiques ont même stoppé la recherche de médicaments, car parvenir à démontrer que de nouvelles molécules sont réellement plus efficaces qu’un placebo est devenu de plus en plus difficile.
Êtes-vous un sujet répondeur ?
Le placebo n’induit un effet que chez un certain pourcentage de la population tout venant. Ce qui a permis d’identifier les critères des sujets répondeurs comparativement aux patients ordinaires. À ce jour, ont été retenus :
- La prédisposition génétique : un gène, au moins, détermine le niveau de réponse au placebo. Selon le variant (mutation génétique ne s’exprimant que dans un contexte spécifique), l’amélioration des symptômes peut être doublée comparativement à celle observée avec ...
Cet article est réservé à nos abonnés. Vous êtes abonnés ? Connectez-vous
Pourquoi cet article est réservé aux abonnés ?
Depuis maintenant près de 30 ans, Alternative Santé promeut les bienfaits des médecines douces ou des approches complémentaires.
Alors qu'elle sont attaquées de toute part avec la plus grande virulence, notre missions est plus que jamais essentielle pour défendre une autre vision de la santé.
C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour nous soutenir dans nos actions d'information. En effet, si nous souhaitons garder notre indépendance éditoriale, seul votre soutien financier peut nous permettre de continuer notre mission :
- celle de dénoncer les scandales et dérives inquiétantes dans le monde de la santé, de mettre en lumière les effets indésirables
- celle de faire connaitre les solutions préventives et les remèdes naturels efficaces au plus grand nombre
- celle de défendre le droit des malades, des usagers de santé et des médecins à choisir librement les meilleurs remèdes.
Comme vous le savez certainement, nous ne mettons aucune publicité dans notre journal et restons libres de toute pression. Nous souhaitons garder toute notre indépendance, mais cette liberté a un coût.
La meilleure façon de nous aider et de soutenir une presse indépendante est donc de vous abonner à notre journal !
Je m'abonne
En aucun cas les informations et conseils proposés sur le site Alternative Santé ne sont susceptibles de se substituer à une consultation ou un diagnostic formulé par un médecin ou un professionnel de santé, seuls en mesure d’évaluer adéquatement votre état de santé


 Découvrir le numéro
Découvrir le numéro 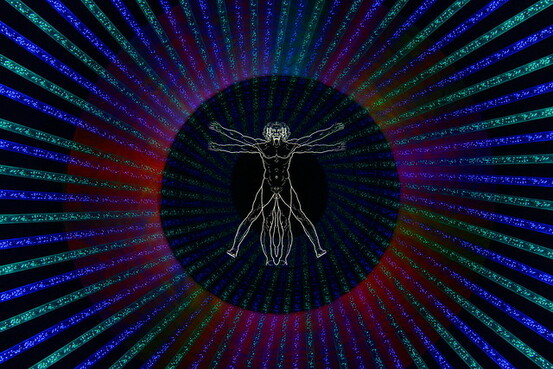



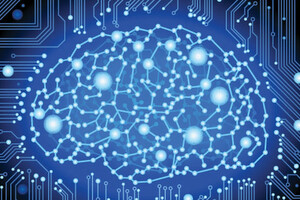
Regard sur le placebo : au-delà des préjugés
Physiologie du placebo
Le corps médical face
à l’effet placebo
Traitement : la puissance du mental