Accueil Dossiers Physiologie du placebo
Physiologie du placebo
Le fait qu’il existe des sujets répondeurs et d’autres non répondeurs au placebo suggère qu’un certain nombre de conditions doivent être regroupées pour qu’il y ait production d’effets thérapeutiques – et d’effets indésirables. Présentation du produit et rituel de la prescription ont ici toute leur importance.
Plus nombreux sont les facteurs favorisants au même instant, plus grande est la probabilité que le placebo exerce ses effets chez davantage de personnes et de façon plus intense. Comment, dans ce cadre, le praticien va-t-il trouver la bonne façon d’être et d’agir vis-à-vis du patient ?
Sa prestance (son élégance sans excès, son attitude droite, ferme et souple à la fois, son calme en toute circonstance) et la distance respectueuse qu’il mettra (moi, je suis le médecin, vous, vous êtes mon patient, nos rôles sont clairs) lui donneront les moyens d’y parvenir, tout comme sa capacité à développer un toucher délicat. Un contact apaisant permet au patient de se laisser aller aux mains médicales.
Tout est dans la présentation
L’industrie pharmaceutique est bien consciente de l’impact de l’effet placebo. Elle dépense donc chaque année des sommes considérables pour que ses produits soient le plus acceptés possible par les malades auxquels ils seront prescrits, en jouant sur d’autres ressorts que sur l’efficacité médicale.
Ses recherches concernent la dénomination commerciale, l’étiquette, l’emballage, la forme, la taille, la posologie, la couleur, le goût – en lien avec le type de clientèle auquel le médicament s’adresse et la pathologie dont il souffre. Voici quelques exemples de produits ainsi « pensés » au niveau marketing :
- Le Di-Antalvic – aujourd’hui retiré du marché – véhiculait l’idée d’une double action (di-) prometteuse de victoire (-vic) sur la douleur (-al, du mot algie, synonyme de douleur). De même avec le Levitra : cette dénomination évoque non seulement le problème de la dysfonction érectile, mais encore sa résolution.
- Le Prozac, présenté comme la pilule du bonheur, a connu un rapide succès commercial, d’autant qu’il initiait une nouvelle classe d’antidépresseurs, donc porteuse de l’espoir d’une amélioration sensible des résultats comparativement aux produits jusque là prescrits.
- La forme en cœur des comprimés de Cardensiel, prescrit en cas d’insuffisance cardiaque, évoque l’infini pouvoir guérisseur de l’amour.
- La couleur bleue du Viagra renvoie à la détente : tout va bien se passer, on n’a plus de raison de stresser à propos de sa capacité à assurer !
La taille compte
D’autres leviers peuvent encore être actionnés. Ainsi, plus petite est la taille de la pilule, de la gélule ou du comprimé, plus grande est sa puissance supposée. Le caractère sécable de certains comprimés joue sur cette corde sensible : s’il est possible de n’en prendre qu’un quart au lieu d’un entier, c’est que même à cette dose infime, le médicament est déjà suffisamment actif pour induire des effets bénéfiques.
En outre, une moindre dose engendre moins d’effets ...
Cet article est réservé à nos abonnés. Vous êtes abonnés ? Connectez-vous
Pourquoi cet article est réservé aux abonnés ?
Depuis maintenant près de 30 ans, Alternative Santé promeut les bienfaits des médecines douces ou des approches complémentaires.
Alors qu'elle sont attaquées de toute part avec la plus grande virulence, notre missions est plus que jamais essentielle pour défendre une autre vision de la santé.
C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour nous soutenir dans nos actions d'information. En effet, si nous souhaitons garder notre indépendance éditoriale, seul votre soutien financier peut nous permettre de continuer notre mission :
- celle de dénoncer les scandales et dérives inquiétantes dans le monde de la santé, de mettre en lumière les effets indésirables
- celle de faire connaitre les solutions préventives et les remèdes naturels efficaces au plus grand nombre
- celle de défendre le droit des malades, des usagers de santé et des médecins à choisir librement les meilleurs remèdes.
Comme vous le savez certainement, nous ne mettons aucune publicité dans notre journal et restons libres de toute pression. Nous souhaitons garder toute notre indépendance, mais cette liberté a un coût.
La meilleure façon de nous aider et de soutenir une presse indépendante est donc de vous abonner à notre journal !
Je m'abonne
En aucun cas les informations et conseils proposés sur le site Alternative Santé ne sont susceptibles de se substituer à une consultation ou un diagnostic formulé par un médecin ou un professionnel de santé, seuls en mesure d’évaluer adéquatement votre état de santé


 Découvrir le numéro
Découvrir le numéro 

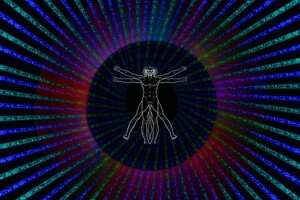

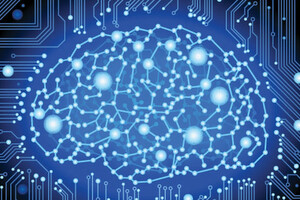
Regard sur le placebo : au-delà des préjugés
Stratagème placebo :
une efficacité déstabilisante
Le corps médical face
à l’effet placebo
Traitement : la puissance du mental