Accueil Conseils santé Bains froids :quels effets sur la santé ?
Bains froids :quels effets sur la santé ?
Pratiqués de longue date en Europe du Nord ou en Russie, et remis depuis quelques années à l’honneur par Win Hoff (le Néerlandais surnommé l’« Homme de glace »), les bains froids ont aujourd’hui la cote, aussi bien auprès du grand public que des chercheurs. Bénéfiques pour le système cardiaque, immunitaire ou respiratoire, ils auraient également une influence sur notre santé mentale et notre tolérance à la douleur. De quoi donner envie de tenter le grand plongeon !
Pendant les vacances, bon nombre d’entre nous irons nous baigner, en bord de mer, dans un lac ou une rivière, milieux dont les eaux ne sont pas toujours à température tropicale. Mais ne vous en désolez pas, car s’immerger en eau froide présente de nombreuses vertus pour la santé, comme en témoignent des milliers de personnes adorant se baigner en extérieur, dans des eaux dont la température oscille entre 0 et 15 °C selon les latitudes. Au Royaume-Uni, dans les pays scandinaves, en Russie ou aux États-Unis, ces baigneurs un peu « frappés » ne tarissent pas d’éloges sur les bénéfices pour la santé de leur activité favorite qui fait l’objet, d’ailleurs, d’un nombre croissant d’études, ainsi que de nombreux reportages dans les médias.
Ainsi en Grande-Bretagne, une étude de cas s’est retrouvée dans un épisode d’une série documentaire de la BBC intitulée The Doctor Who Gave Up Drugs ; il s’agissait d’une jeune femme (Sarah) alors âgée de 24 ans, dépressive depuis l’âge de 17 ans, et dont les symptômes s’étaient avérés résistants à la fluoxetine (principe actif du fameux Prozac) puis au citalopram. Après la naissance de sa fille, désireuse de se libérer à la fois de sa dépression et de ses médicaments, Sarah a accepté d’expérimenter un programme de nage en eau froide et en plein air. Après trois mois (sur un programme de six au total) à raison d’un ou deux bains hebdomadaires, elle ne répondait plus aux critères officiels de la dépression et n’avait plus besoin de médicaments, situation toujours stabilisée un an après le début de l’expérience.
Lire aussi Thalassothérapie et santé : la mer pour partenaire
L'immersion en eau froide : quels effets sur la santé ?
Les témoignages relatifs à des effets similaires sur la dépression et d’autres désordres cognitifs sont nombreux. D’ailleurs, les auteurs de l’étude initiale dont Sarah a fait l’objet ont, par la suite, lancé un appel auprès de l’Outdoor Swimming Society (une communauté de nageurs en extérieur) afin de poursuivre ses investigations sur un public plus large. Espérant une quarantaine de candidats, l’initiative a collecté plus de 600 contacts désireux de partager leurs expériences sur l’anxiété, la dépression, l’addiction, la migraine ou encore l’arthrite.
Ces activités, allant de la simple immersion de quelques minutes au bain froid érigé en tant que sport en passant par la plongée, sont organisées de plus en plus souvent au sein d’associations, de clubs et autres groupes comme le Coney Island Polar Bear Club, près de New-York, la plus ancienne organisation de bains hivernaux aux États-Unis.
La gestion du stress est l’une des motivations citées le plus souvent par ses membres. D’après les scientifiques qui s’intéressent au phénomène, l’immersion en eau froide stimule la réponse combat-fuite au stress extrême, qui court-circuite complètement notre cerveau conscient, pour ne faire appel qu’à la réponse réflexe pure. Ce processus déclenche une décharge immédiate de différentes hormones (adrénaline, cortisol) et ...
Cet article est réservé à nos abonnés. Vous êtes abonnés ? Connectez-vous
Pourquoi cet article est réservé aux abonnés ?
Depuis maintenant près de 30 ans, Alternative Santé promeut les bienfaits des médecines douces ou des approches complémentaires.
Alors qu'elle sont attaquées de toute part avec la plus grande virulence, notre missions est plus que jamais essentielle pour défendre une autre vision de la santé.
C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour nous soutenir dans nos actions d'information. En effet, si nous souhaitons garder notre indépendance éditoriale, seul votre soutien financier peut nous permettre de continuer notre mission :
- celle de dénoncer les scandales et dérives inquiétantes dans le monde de la santé, de mettre en lumière les effets indésirables
- celle de faire connaitre les solutions préventives et les remèdes naturels efficaces au plus grand nombre
- celle de défendre le droit des malades, des usagers de santé et des médecins à choisir librement les meilleurs remèdes.
Comme vous le savez certainement, nous ne mettons aucune publicité dans notre journal et restons libres de toute pression. Nous souhaitons garder toute notre indépendance, mais cette liberté a un coût.
La meilleure façon de nous aider et de soutenir une presse indépendante est donc de vous abonner à notre journal !
Je m'abonne
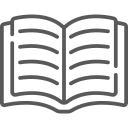 Références bibliographiques
Références bibliographiques 
En aucun cas les informations et conseils proposés sur le site Alternative Santé ne sont susceptibles de se substituer à une consultation ou un diagnostic formulé par un médecin ou un professionnel de santé, seuls en mesure d’évaluer adéquatement votre état de santé


 Découvrir le numéro
Découvrir le numéro  L’immersion en eau froide stimule la circulation sanguine.
L’immersion en eau froide stimule la circulation sanguine.
L'eau,
même chez nous
on en manque
Du pain + de l'eau = un remède miracle
Le sel cristallin de l'Himalaya : de l'eau de mer préhistorique