Accueil Conseils santé Galénique, tout est question de formes
Galénique, tout est question de formes
Vous êtes nombreux à nous demander la différence entre comprimé enrobé et classique, ou quel est l’intérêt d’une forme liposomale, d’un comprimé à libération prolongée ou même d’un suppositoire ? Tout est question de galénique, autant pour un médicament que pour un remède à base de plantes.
Galénique ? Quel est ce mot qui revient souvent dans la bouche des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie ? Que veut-il bien dire ? Il vient du nom de l’illustre médecin et pharmacien de l’empereur romain Marc Aurèle : Claudius Galenus. Galien, comme on l’appelle aussi, publia, il y a plus de mille huit cents ans, près de 400 ouvrages sur la médecine et la formulation de remèdes.
La galénique, à proprement parler, est la science et l’art de préparer, conserver et présenter les médicaments. Par extension, on parle de forme galénique pour tous les composants d’une préparation : le ou les principes actifs pour les médicaments, des extraits de plantes pour des mélanges en phytothérapie, mais aussi les substances inertes ou excipients, ainsi que la forme sous laquelle la formulation est présentée (gélule, lotion, crème, suppositoires, etc.).
Ainsi, l’une des responsabilités du galéniste est le contrôle des matières premières, des articles de conditionnement (flacons, emballages) ainsi que du matériel et de l’environnement lors de la préparation ou de la production à l’échelle industrielle. La moindre erreur peut être dramatique ! Ces derniers mois, en Indonésie, le composé d’un sirop utilisé comme solvant (le glycol) s’est retrouvé en excès dans de nombreux lots, provoquant le décès de plus d’une centaine d’enfants.
Des formes galéniques pour atteindre la source du mal
Mais cette discipline est bien plus qu’un simple mode opératoire de fabrication et de contrôle : elle va devoir trouver toutes les astuces pour que les substances actives atteignent l’origine de la pathologie. Ce qui fait de la galénique un véritable savoir-faire, qui se transmet depuis notre cher Galien, et même bien avant.
La référence qui fait aujourd’hui autorité en France est la Pharmacopée européenne (du grec farmakopoiía : " l’art de préparer les médicaments "), qui classe les différentes formes galéniques en fonction de leur mode d’administration. On peut distinguer celles qui vont traiter localement et d’autres qui vont avoir un champ d’action plus global (comme la voie orale).
Pour traiter localement, les portes d’entrées sont variées : il y a d’abord la voie cutanée, une porte très bien gardée, car c’est celle qui nous protège de l’extérieur. Elle peut toutefois être traversée par des substances lipophiles (qui se mélangent aux corps gras), comme c’est le cas des huiles essentielles. Leur pénétration cutanée se fait en quelques minutes. De plus, si on les mélange avec une huile végétale, en fonction de leur capacité de pénétration, les huiles peuvent être amenées très en profondeur dans notre organisme, jusqu’à rejoindre la microcirculation sanguine périphérique, et même certains organes. Par exemple, si on veut traiter une infection qui a lieu en surface, on peut utiliser de l’huile végétale de jojoba ou de neem (qui reste en surface). Si on veut aller plus en profondeur, on peut utiliser des huiles végétales de noisette ou de noyau d’abricot, qui ...
Cet article est réservé à nos abonnés. Vous êtes abonnés ? Connectez-vous
Pourquoi cet article est réservé aux abonnés ?
Depuis maintenant près de 30 ans, Alternative Santé promeut les bienfaits des médecines douces ou des approches complémentaires.
Alors qu'elle sont attaquées de toute part avec la plus grande virulence, notre missions est plus que jamais essentielle pour défendre une autre vision de la santé.
C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour nous soutenir dans nos actions d'information. En effet, si nous souhaitons garder notre indépendance éditoriale, seul votre soutien financier peut nous permettre de continuer notre mission :
- celle de dénoncer les scandales et dérives inquiétantes dans le monde de la santé, de mettre en lumière les effets indésirables
- celle de faire connaitre les solutions préventives et les remèdes naturels efficaces au plus grand nombre
- celle de défendre le droit des malades, des usagers de santé et des médecins à choisir librement les meilleurs remèdes.
Comme vous le savez certainement, nous ne mettons aucune publicité dans notre journal et restons libres de toute pression. Nous souhaitons garder toute notre indépendance, mais cette liberté a un coût.
La meilleure façon de nous aider et de soutenir une presse indépendante est donc de vous abonner à notre journal !
Je m'abonne
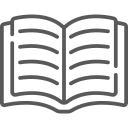 Références bibliographiques
Références bibliographiques 
En aucun cas les informations et conseils proposés sur le site Alternative Santé ne sont susceptibles de se substituer à une consultation ou un diagnostic formulé par un médecin ou un professionnel de santé, seuls en mesure d’évaluer adéquatement votre état de santé


 Découvrir le numéro
Découvrir le numéro  Les formes galéniques par voie orale sont les plus nombreuses.
Les formes galéniques par voie orale sont les plus nombreuses.
La curcumine liposomale régule l’humeur et stimule la mémoire des seniors
Le glutathion liposomé, le plus puissant des antioxydants
Nouveau regard sur la nutrition : la matrice alimentaire
Curcumine et quercétine : attention aux interactions en cas de chimiothérapie