Accueil Entretiens "Nous mettons en danger les patients" interview Léonard Corti
"Nous mettons en danger les patients" interview Léonard Corti
Léonard Corti débute son internat en réanimation pendant la première vague de Covid. Il décrit dans son livre* le quotidien d’un soignant payé 1 600 euros net par mois pour des semaines de soixante heures. Il raconte surtout la lente agonie d’une institution : l’hôpital.
Quel est l’objectif de votre livre ?
J’aimerais que ce témoignage permette d’expliquer ce que signifie un hôpital qui ne fonctionne pas bien, ce que c’est pour un médecin, pendant la première vague de Covid, de ne disposer que d’un masque pour 24 heures, de porter des surblouses en sac-poubelle ou de ne pas avoir assez de tests à destination des patients déclarant un Covid à l’hôpital. Il m’a paru essentiel de rappeler que le Covid est venu s’ajouter à une crise profonde. Au cours des mois de mobilisation sociale précédant la pandémie, l’ensemble du personnel médical, à l’exception des directeurs, était déjà rassemblé pour alerter sur l’état catastrophique de l’hôpital.
Quel regard portez-vous aujourd’hui sur l’hôpital ?
Cette institution a connu son apogée au début du XXIe siècle, et le système de santé français était décrit comme le meilleur du monde. Suite à la crise de 2008, les politiques d’austérité se sont enchaînées, conduisant l’hôpital à laisser s’envoler des compétences et des ressources dont nous avons cruellement manqué durant cette crise. Lorsque l’on constate qu’au moment de la cinquième vague de Covid, il est impossible d’ouvrir autant de lits que lors de la première par manque de personnel, on comprend que c’est l’humain qui est la clef de voûte du système de santé. Un grand corps malade tenu à bout de bras par des soignants comme moi, interne de première année, qui se retrouvent à porter une responsabilité toujours plus lourde sans y être préparés. La frustration que cela crée chez les soignants est ce qui mène l’hôpital à sa perte.
Votre témoignage peut-il faire bouger les choses ?
Je n’ai pas cette prétention mais garder une trace écrite de ce que j’ai vécu m’a paru important. Certains collègues se reconnaîtront sûrement dans mon livre. J’échange beaucoup avec mes proches sur ce que je vis, mais avec une certaine pudeur. Je me suis senti plus libre en écrivant. En mettant à distance, je me suis rendu compte que j’avais vécu des situations particulièrement violentes, pas forcément perçues comme telles sur le moment.
Vous décrivez une scène apocalyptique qui reflète bien votre titre. Est-ce classique dans un service d’urgence ?
Oui, je me souviens que je soignais une étudiante en médecine pour une attaque de panique. Dès que nous sommes sortis de la pièce et avons pénétré dans le service d’urgence, j’ai vu qu’elle jetait un regard mi-effaré mi- effrayé autour d’elle. J’ai alors pris conscience du chaos absolu qui régnait, et auquel je n’avais pas prêté attention jusque-là. Une femme vomissait sur son brancard, tandis qu’à côté passait un homme rachitique, la blouse de l’hôpital ouverte à l’arrière laissant apparaître un dos nu noueux et des fesses flasques. Des gouttes de sang perlaient depuis son bras duquel il avait arraché la perfusion. Un patient psychotique que j’avais aidé plus tôt à « contentionner » hurlait et se déplaçait pieds et poings liés à son brancard, en portant celui-ci sur son dos… J’ai compris à cet instant qu’on pouvait s’habituer à tout.
Nous soignants, travaillons donc dans des environnements très violents. Les conséquences sur notre état psychologique ne sont pas anodines. Des études révèlent que les soignants des urgences sont en permanence sollicités, ce qui conduit à des burn out mais aussi à un phénomène sous- estimé : l’émoussement affectif. À cause de cette surcharge de travail, nous avons la sensation de perdre le sens de notre mission et notre capacité à être en empathie, ce qui est évidemment grave dans nos relations avec les patients.
Lire aussi
La souffrance des soignants
Pouvez-vous revenir sur votre internat de médecine commencé en novembre 2019 ?
À cette époque, j’étais représentant syndical au niveau national. En février 2020, nous sommes vite conscients de la pandémie à laquelle il faut faire face. Nous suspendons le préavis de grève et je me porte volontaire pour travailler aux urgences de la Pitié Salpêtrière, à Paris. Je vis une période intense avec des gardes dans divers services. Je vois comment les services non Covid sont laissés à la traîne : lorsqu’un cas de Covid est déclaré, plutôt que de tester tout le monde et de faire sortir ceux qui ne sont pas atteints, le service est bouclé. Les décideurs partent du principe que l’épidémie va s’y répandre. Cette logique a conduit à une hécatombe en gériatrie. La deuxième vague est arrivée très tôt. Dès mi-août, alors que toutes les restrictions sanitaires sont levées, le service se remplit de patients Covid. Et le reconfinement est décidé en… octobre. À une grosse mobilisation pour la première vague, succède la volonté politique de laisser circuler le virus avec pour conséquence une pression constante sur l’hôpital. Les considérations économiques et politiques ont pris le dessus.
Vous évoquez la verticalité du fonctionnement politique français durant cette crise…
Un conseil de défense sanitaire est utile en temps de guerre afin de ne pas donner d’informations à un adversaire qui pourrait l’utiliser contre nous. Mais là on parle d’un virus… Cela ne me paraît pas justifié dans une démocratie de prendre des décisions en comité restreint, sans que nous soyons informés de la composition de ce conseil et sans compte rendu. Si le message avait été franc, nous n’aurions pas l’impression d’avoir été pris pour des imbéciles par un gouvernement paternaliste. La défiance vis-à-vis de la vaccination est aussi liée à la manière dont les politiques communiquent, et à l’absence de concertation et de débat citoyen.
Lire aussi Ne tirez plus sur l’hôpital, par Minou Azoulai (éd. Hugo)
Après l’épreuve de la première vague, rien, écrivez-vous, ne pouvait être refusé aux soignants. Le Ségur de la santé a-t-il changé les choses ?
Le Ségur a donné lieu à des augmentations de salaires qui n’étaient qu’un rattrapage de l’inflation. Les salaires étaient gelés depuis... 2010. Après, le gouvernement a fermé la porte des négociations. Tout cela se traduit par le départ en masse des soignants. Dans une récente interview, le ministre de la Santé se délivre un autosatisfecit ; je ne vois pas comment cette mentalité peut faire évoluer les choses positivement. En écrivant ce livre, j’avais le pressentiment que l’hôpital serait, après ce que l’on vient de vivre, paradoxalement peu présent dans la campagne présidentielle. C’est incroyable de ne pas avoir eu de débat sur la santé après une pandémie qui a tué près de 150 000 personnes en France. Du côté des politiques, le déficit de compréhension des enjeux de la santé est énorme. Rares sont ceux capables d’avoir une vision à la fois pragmatique et ambitieuse. Pour la première vague, l’État a injecté entre 12 et 15 milliards d’euros dans l’hôpital pour qu’il ne s’effondre pas. C’est peu ou prou ce qu’il a « économisé » en dix ans de politiques d’austérité budgétaire…
Le métier d’infirmière a été revalorisé dans la plupart des pays européens. La France est parmi les derniers sur ce plan. Qu’est-ce que cela vous inspire ?
Cela m’évoque un article du Canard enchaîné à propos des blocs opératoires de l’hôpital Georges-Pompidou à Paris, qui fonctionnent au ralenti faute d’infirmières spécialisées. Les patients polytraumatisés ne peuvent plus y être pris en charge. Cela a concerné notamment le jeune homme qui avait été blessé par un policier à Sevran. Conduit à Pompidou, il n’a pu y être admis et a été transféré à la Pitié, où il est décédé. Certains médecins témoignent d’une perte de chance réelle pour les patients parce qu’il n’y a plus assez de personnel pour faire tourner des blocs. Je pense qu’il faut que nous, soignants, arrêtions de culpabiliser de mal soigner les gens. Nous mettons en danger les patients parce que l’on ne nous donne pas les moyens de bien faire.
La médecine préventive vous tient à cœur. Pourquoi ?
C’est l’avenir ! Le Covid a mis le doigt sur l’épidémie de maladies chroniques – hypertension, diabète… – sans qu’aucun plan gouvernemental ne soit déployé pour lutter contre. Les problématiques sanitaires devraient être incluses dans l’ensemble des politiques publiques : l’agriculture, l’environnement ou les transports. J’ai trouvé insupportable de voir de la publicité pour des fast-foods quand, dans le même temps, je soignais des patients obèses en réanimation. La logique de l’industrie agroalimentaire coûte plus cher que ce qu’elle rapporte.
* Dans l’enfer de l’hôpital, éd. Robert Laffont, 198 p., 2022, 18 €.
En aucun cas les informations et conseils proposés sur le site Alternative Santé ne sont susceptibles de se substituer à une consultation ou un diagnostic formulé par un médecin ou un professionnel de santé, seuls en mesure d’évaluer adéquatement votre état de santé


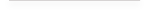 Découvrir le numéro
Découvrir le numéro  "C’est l’humain qui est la clef de voûte du système de santé."
"C’est l’humain qui est la clef de voûte du système de santé."
La vitamine C écourte
les séjours à l'hôpital
Bactéries résistantes à l'hopital
Omerta à l’hôpital
Des nouvelles du front des Ehpad
Un cheveu de 530 km
Association de patients : au service de l’industrie ?