Accueil Traitements Monde marin : un puit de remède
Monde marin : un puit de remède
Alors que nous manquons cruellement de nouveaux traitements dans de nombreux domaines de la santé, la solution pourrait bien se situer sous la surface de nos mers et océans qui recouvrent 70 % du globe. Plongée dans le monde fascinant des algues, des éponges et des concombres de mer qui intéressent aujourd’hui la médecine.
Dans les conditions de vie différentes de celles qui règnent sur le plancher des vaches, parfois extrêmes en température ou en pression, pauvres en lumière et en oxygène, les organismes marins ont évolué différemment et développé des composés extrêmement actifs aux structures chimiques très originales. En effet, il faut que ces molécules soient des plus puissantes pour être actives même immédiatement diluées dans l’eau de mer environnante. Concombres de mer, éponges, cnidaires et champignons des fonds marins sont ainsi source de molécules aux structures chimiques peu connues jusqu’ici, qui nous permettront peut-être de développer de nouveaux antibiotiques ainsi que des traitements anticancéreux ou anti-inflammatoires innovants dans le futur. Il est plus qu’urgent de protéger ces écosystèmes qui nous inspireront peut-être notre future pharmacie, avant même que cette dernière ait disparu sans révéler une grande partie de ses secrets.
Les bactéries marines, productrices des anticancéreux de demain ?
On compte pas moins d’un milliard de bactéries par litre d’eau de mer, dont beaucoup sont encore méconnues. Parmi elles, on trouve des bactéries qui produisent des molécules dérivées (métabolites) aux structures tout à fait surprenantes, comme les lactames, issus de la bactérie Streptomyces sp. Ces composés, puissamment antioxydants, sont capables de moduler le développement de l’inflammation, du cancer et du vieillissement. Les scientifiques ont retrouvé nombre d’autres métabolites marins similaires, comme l’altéramide A, un alcaloïde issu d’une bactérie ou la cyrindramine d’une éponge marine.
Les chercheurs en sont même venus à la conclusion que les bactéries présentes dans les végétaux et animaux de la mer sont probablement les principales productrices de ces métabolites marins, ce qui ouvre d’énormes perspectives pour la production industrielle de futurs médicaments : au lieu d’épuiser certaines espèces marines, allant à contresens d’une préservation de la faune et de la flore, on pourrait faire produire les molécules d’intérêt thérapeutique par ces bactéries, sous réserve bien entendu de trouver les bonnes conditions de culture microbiologique. Parmi les molécules plébiscitées par la recherche clinique, les protéines à activité enzymatique constituent actuellement une demande importante pour la prise en charge des leucémies et des lymphomes. Dans ce contexte, la L-asparaginase, une enzyme issue de Bacillus subtilis, a un grand potentiel de développement de traitements anticancéreux.
Les cyanobactéries, ce qu’on appelait auparavant les « algues bleues », ne sont pas en reste : ces microorganismes capables de photosynthèse et faisant partie du phytoplancton nous réservent aussi de belles surprises. En effet, des dérivés de Lyngbya sp. sont anticancéreux et antiostéoporotiques, tandis ...
Cet article est réservé à nos abonnés. Vous êtes abonnés ? Connectez-vous
Pourquoi cet article est réservé aux abonnés ?
Depuis maintenant près de 30 ans, Alternative Santé promeut les bienfaits des médecines douces ou des approches complémentaires.
Alors qu'elle sont attaquées de toute part avec la plus grande virulence, notre missions est plus que jamais essentielle pour défendre une autre vision de la santé.
C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour nous soutenir dans nos actions d'information. En effet, si nous souhaitons garder notre indépendance éditoriale, seul votre soutien financier peut nous permettre de continuer notre mission :
- celle de dénoncer les scandales et dérives inquiétantes dans le monde de la santé, de mettre en lumière les effets indésirables
- celle de faire connaitre les solutions préventives et les remèdes naturels efficaces au plus grand nombre
- celle de défendre le droit des malades, des usagers de santé et des médecins à choisir librement les meilleurs remèdes.
Comme vous le savez certainement, nous ne mettons aucune publicité dans notre journal et restons libres de toute pression. Nous souhaitons garder toute notre indépendance, mais cette liberté a un coût.
La meilleure façon de nous aider et de soutenir une presse indépendante est donc de vous abonner à notre journal !
Je m'abonne
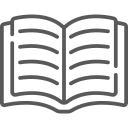 Références bibliographiques
Références bibliographiques 
"Current Status and Future Prospects of Marine Natural Products (MNPs) as Antimicrobials", Drugs 2017. https://doi.org/10.3390/md15090272
"Marine drugs: Biology, pipelines, current and future prospects for production", Biotechnology Advances, 2022. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2021.107871
"Anti-hyperglycemic and antioxidant effect of fucoidan extract from Lessonia trabeculata in alloxan-induced diabetes rats", Journal of Applied Phycology 2022.
"New pharmaceuticals from marine organisms", Trends in Biotechnology, 1997. https://doi.org/10.101/S0167-7799(97)01081-0
"The Use of Acellular Fish Skin Grafts in Burn Wound Management—A Systematic Review", Medicina (Kaunas). 2022. doi: 10.3390/medicina58070912
"Topical reinforcement of the cervical mucus barrier to sperm", Science Translational Medicine, 30 Nov 2022. DOI: 10.1126/scitranslmed.abm2417
En aucun cas les informations et conseils proposés sur le site Alternative Santé ne sont susceptibles de se substituer à une consultation ou un diagnostic formulé par un médecin ou un professionnel de santé, seuls en mesure d’évaluer adéquatement votre état de santé


 Découvrir le numéro
Découvrir le numéro  Un futur anti-ostéoporose à partir de l'anémone coloniale ? (lZoanthus sp)
Un futur anti-ostéoporose à partir de l'anémone coloniale ? (lZoanthus sp)
L’humus : un potentiel thérapeutique retrouvé ?
Les algues, des bombes nutritionnelles ?
De futurs antihypertenseurs extraits de la chlorelle ?