Accueil Polémiques Maladie de Parkinson : une étude confirme le rôle du trichloroéthylène
Maladie de Parkinson : une étude confirme le rôle du trichloroéthylène
On ne connaît toujours pas les causes précises de la maladie de Parkinson, en progression constante depuis plusieurs décennies. Néanmoins, des facteurs environnementaux sont régulièrement évoqués. Figure sur la liste l'exposition au trichloroéthylène (ou trichloréthylène), utilisé pendant des décennies dans bon nombre d’industries et de produits d'usage courant par la population.
On ne connaît toujours pas les causes précises de la maladie de Parkinson, en progression constante depuis plusieurs décennies. Néanmoins, des facteurs environnementaux sont régulièrement évoqués. Le trichloroéthylène (ou trichloréthylène) figure sur la liste ; ce solvant très puissant et volatil , dont la génotoxicité est reconnue et la cancérogénicité considérée comme probable (ou avérée selon les pays), a été longtemps utilisé dans bon nombre d’industries ou de procédés, comme la métallurgie, l’électronique, la décaféination, le caoutchouc, le nettoyage à sec, la fabrication de produits d’entretien ou de peintures.
Il entrait dans la composition de nombreux produits (réfrigérants, lubrifiants, adhésifs, teintures…) et a même connu une courte carrière d’anesthésique et d’analgésique par inhalation ! La règlementation l’a peu à peu évincé de certains secteurs, comme les pressings, au profit du perchloroéthylène, avec une obligation de remplacement avant 2016 dans l’Union européenne pour tous les industriels.
Lire aussi Le diesel, autre carburant du Parkinson ?
Bien qu’invisible, ce polluant est encore omniprésent
Mais l’utilisation massive du trichloroéthylène (TCE) depuis les années 1930, sans réelles précautions ni pour l’homme ni pour l’environnement, a conduit à des situations de maladies professionnelles et de pollution de l’environnement : sols, eaux souterraines, réseaux d’eau potable et air. Dans la population générale, la voie de contamination principale est probablement l’inhalation, notamment par l’eau de réseau d’où le TCE s’évapore facilement lorsque celle-ci est contaminée. Bien que les soupçons sur le rôle du trichloroéthylène dans le développement de Parkinson datent de plus de cinquante ans, les mesures de précaution ou de ...
Cet article est réservé à nos abonnés. Vous êtes abonnés ? Connectez-vous
Pourquoi cet article est réservé aux abonnés ?
Depuis maintenant près de 30 ans, Alternative Santé promeut les bienfaits des médecines douces ou des approches complémentaires.
Alors qu'elle sont attaquées de toute part avec la plus grande virulence, notre missions est plus que jamais essentielle pour défendre une autre vision de la santé.
C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour nous soutenir dans nos actions d'information. En effet, si nous souhaitons garder notre indépendance éditoriale, seul votre soutien financier peut nous permettre de continuer notre mission :
- celle de dénoncer les scandales et dérives inquiétantes dans le monde de la santé, de mettre en lumière les effets indésirables
- celle de faire connaitre les solutions préventives et les remèdes naturels efficaces au plus grand nombre
- celle de défendre le droit des malades, des usagers de santé et des médecins à choisir librement les meilleurs remèdes.
Comme vous le savez certainement, nous ne mettons aucune publicité dans notre journal et restons libres de toute pression. Nous souhaitons garder toute notre indépendance, mais cette liberté a un coût.
La meilleure façon de nous aider et de soutenir une presse indépendante est donc de vous abonner à notre journal !
Je m'abonne
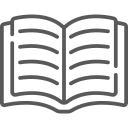 Références bibliographiques
Références bibliographiques 
[1] « Trichloroethylene: An Invisible Cause of Parkinson’s Disease? », Journal of Parkinson’s Disease, mars 2023 – doi : 10.3233/JPD-225047
En aucun cas les informations et conseils proposés sur le site Alternative Santé ne sont susceptibles de se substituer à une consultation ou un diagnostic formulé par un médecin ou un professionnel de santé, seuls en mesure d’évaluer adéquatement votre état de santé


 Découvrir le numéro
Découvrir le numéro  Le trichloroéthylène augmente le risque de maladie de Parkinson
Le trichloroéthylène augmente le risque de maladie de Parkinson